A Lille, une vingtaine de jeunes exilés dorment dans un campement de tentes, malgré le froid et la trêve hivernale. Mineurs mais jugés majeurs à la suite d’une évaluation de leur âge par les services des départements, ils se retrouvent dans un vide juridique et ne peuvent bénéficier ni des systèmes de solidarité étatique, ni de l’aide sociale à l’enfance du département. Pour pallier ce manque de prise en charge, les bénévoles de l’association Utopia56 les accompagnent dans les demandes de réévaluation de leur dossier et leur apportent de quoi subvenir à leurs besoins vitaux.
Le campement de fortune se situe à l’écart des axes routiers. Il est protégé des regards par la végétation et un ensemble de bâches bleues. Les jeunes qui l’occupent dorment dans des tentes. Tous les samedis, une équipe de bénévoles de l’association Utopia56 vient leur rendre visite. L’occasion d’en savoir plus sur la situation de ces jeunes, et sur l’aide qui leur est offerte.
A leur arrivée sur le territoire français, tous ont été déclarés majeurs après un entretien d’une heure. Durant cette évaluation de leur âge, ils ont dû donner des informations sur leur état civil, leur famille, leur scolarisation au pays, leur parcours migratoire et leur projet de vie en France. Selon Lucille, coordinatrice d’Utopia 56 Lille, ce fonctionnement est déshumanisant.
« Il n’y a pas assez de moyens mis dans ce dispositif. C’est l’usine, il font l’évaluation à la chaîne. Il n’y a pas le temps de faire une évaluation sereine. » « C’est difficile aussi, car on force le jeune à se raconter, sans temps de répit. Normalement, ils doivent attendre cinq jours. Ils sont mis à l’abri la veille et évalués le lendemain matin. D’autres ne sont même pas mis à l’abri. Les services attendent des réponses super précises pour des jeunes qui ne sont pas dans de bonnes conditions. » Pour elle, le minimum serait de respecter le temps de répit et la mise à l’abri des jeunes. Elle préconise également aux fonctionnaires chargés de l’entretien de prendre en compte l’avis des travailleurs sociaux.

Les tentes qui constituent le campement
Le droit français offre cependant la possibilité d’un saisine auprès du juge des enfants, afin de statuer sur leur minorité. Mais comme l’explique l’une des bénévole d’Utopia56, « un recours prend en moyenne 6 mois, il faut être en contact avec un avocat et c’est très dur de poursuivre des processus juridiques quand on est à la rue, surtout quand on a accès à aucun soin ou nourriture à côté. » L’association prend alors en charge la demande, veille à leur trouver des places en hébergement, un accompagnement médical, et les oriente vers des distributions alimentaires. Mais les réseaux de solidarité sont aujourd’hui saturés, et les tentes s’imposent comme la seule solution de logement.
Ainsi malgré l’aide des bénévoles, les jeunes exilés se retrouvent confrontés à un dysfonctionnement étatique. Lucille explique qu’ « il n’y a aujourd’hui aucune obligation légale de protection des jeunes en attente de reconnaissance de leur minorité. Et personne ne veut mettre le doigt là-dedans. Et c’est un choix politique de ne rien faire.» L’association demande donc une prise de position de l’Etat, ainsi que la mise en place de « la présomption de minorité, un bénéfice du doute profitant aux jeunes le temps du recours. » « Il faut que les demandeurs soient mis à l’abri le temps de la saisine. Ils ne peuvent pas se retrouver à la rue alors qu’ils ont déjà subi des mois d’errance. »
Une fois passés par la procédure de recours, 82% des jeunes sont reconnus mineurs. Ils bénéficient d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, d’un logement, et vont au lycée. Pour une autre bénévole, « cela facilite les choses car ils peuvent s’intégrer, avoir un cursus scolaire, et trouver un emploi. » L’aide sociale à l’enfance permet également aux jeunes de retrouver un peu d’humanité et de vivre une vie plus tranquille.
L’association Utopia 56 travaille alors à repenser le processus d’accueil des mineurs arrivés sur le territoire français. Avec l’aide de ses bénévoles, elle milite pour une prise en charge plus humaine de ces jeunes, les aide à s’intégrer et à commencer une nouvelle vie sur le territoire français.
Belda Caro
Photos Le Châtillon
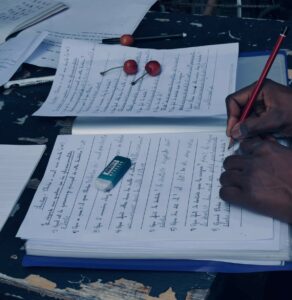
Des cours de français sont dispensés gratuitement par des bénévoles
Retour sur : l'adoption de la loi immigration
Près d’un an après sa première présentation en Conseil des ministres, la loi immigration a été finalement promulguée le 27 janvier 2024. Elle aura connu des navettes parlementaires, une commission mixte paritaire et la censure du Conseil constitutionnel, en raison d’articles qualifiés de cavaliers législatifs – des articles « hors-sujet » n’ayant pas de liens avec la loi. Celui-ci a amputé 35 articles sur 86 à une loi considérée comme « l’une des plus répressives de ces 40 dernières années » sur le contrôle de l’immigration, par les analystes politiques.
Porté par les ministres de l’Intérieur, de la Justice et du travail, le texte initial a été largement durci. Des concessions réalisées pour satisfaire la droite et l’extrême-droite, sans lesquelles la loi n’aurait pas été adoptée. Les Républicains et le Rassemblement National se réjouissent de cette nouvelle loi autant que les gauches la rejettent, ainsi que toutes les associations de solidarité. Une bénévole d’Utopia 56 parle de la loi immigration comme d’une « surenchère absurde, [réalisée pour] calmer une obsession », sur les questions migratoires.
Intitulée « loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », les mesures phares portent sur la régularisation exceptionnelle des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, une carte de séjour « talent » pour les médecins étrangers, le durcissement des conditions d’éligibilité aux prestations sociales… Pour plus d’informations sur le contenu de la loi, rendez-vous sur le site gouvernemental vie-publique.fr
Soline Hariz

