Dans le nord, des associations comme Elles bougent ou Les Pixelles repensent la manière d’encourager les filles à s’orienter vers le domaine scientifique. Au-delà de leurs initiatives originales, elles questionnent un système qui socialise les individus en fonction de leur genre et interrogent un système éducatif qui a sa part de responsabilité.
« Tu connais le principe de la novlangue* ? ». Pour Christine Demeillers, la déléguée régionale Nord – Pas-De-Calais de l’association Elles bougent, la langue inventée par George Orwell dans 1984 illustre parfaitement l’importance du langage inclusif dans la lutte contre les inégalités. Elle préfère ainsi commencer ses mails par « bonjour tout le monde » ou « chers collaborateurs et chères collaboratrices » pour ne pas limiter la pensée ou invisibiliser les femmes. Cela fait partie des petites choses qu’elle a trouvées pour ouvrir les possibles et limiter la reproduction des stéréotypes de genre. Selon cette ingénieure, ces biais sont l’une des causes principales de l’absence de filles en science. « On vit dans un monde où l’on reproduit des schémas » et ces schémas sont justement ceux « d’un monde qui a tendance à valoriser le masculin et à dévaloriser le féminin ». De ce constat naissent alors les « rôles modèles », des ingénieures et femmes scientifiques que l’association met en contact avec des jeunes filles afin de susciter des vocations et prouver que femmes et science ne sont pas incompatibles. Ce combat essentiel cherche alors à s’opposer à une société qui nie les aspirations des filles en les formatant sans leur laisser une chance de devenir ce qu’elles désirent réellement être.
Entre filles
Pour tenter d’affronter les conséquences de la socialisation genrée**, des associations défendent la non-mixité. Le projet Les Pixelles fondé par Hélène Touzet et Mathieu Giraud a fait ce choix en ouvrant un club d’informatique à l’université de Lille réservé uniquement aux collégiennes et lycéennes. L’une de ses membres, l’enseignante Claire Divoy, estime que le projet permet aux jeunes filles de se retrouver entre elles pour « apprendre plus facilement, sans biais sexistes ». La non-mixité engendre de la confiance et les participantes se sentent ainsi plus libres de poser des questions sans être jugées.


La question de la confiance des filles en elles, centrale dans les facteurs aggravant les inégalités, est d’ailleurs abordée frontalement par ces associations. Pour Christine, dire simplement aux filles « osez », revient à leur faire croire que le problème vient d’elles-mêmes. Face à l’hypocrisie de ces injonctions elle propose une autre solution : « Moi ce que je recommande quand on n’ose pas, qu’on n’a pas confiance, c’est de se renseigner. » C’est justement tout le propos d’Elles bougent qui vise à « sortir les jeunes filles de leurs établissements scolaires et de les mettre en situation », démystifier le travail de leurs marraines. Le projet des Pixelles s’inscrit dans une démarche similaire. Ses créateurs ont compris que pour avoir plus de filles en science dans le supérieur, il fallait, non pas leur dire simplement d’oser, mais leur en donner les moyens dès le collège.

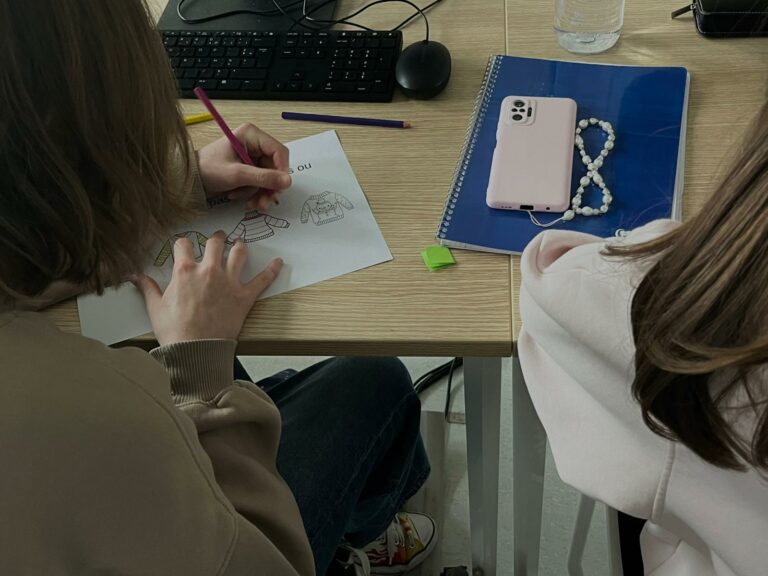
Mais que fait l’État ?
Il semble clair pour Christine Demeillers que la réforme du bac a eu un impact très négatif sur la présence féminine dans les filières scientifiques : « C’est un énorme retour en arrière de 20 ans. » Même si elle souligne l’initiative d’Élisabeth Borne avec son plan « Maths et Filles » qui a permis à l’association d’être plus sollicitée par les établissements scolaires, elle précise discrètement que ce plan est à voir comme une feuille de route car il n’implique aucun financement public pour aider à la mise en place de mesures concrètes. L’Éducation nationale peut donc se réjouir de bénéficier d’un tissu associatif qui lutte à son échelle contre un système qui semble être toujours aussi peu décidé à rendre enfin la science accessible à toutes.
Lucie Delvoye
*La novlangue est une langue fictive créée dans le but de limiter la pensée et rendre impossible de dire et donc penser certaines choses.
**La socialisation genrée correspond au fait d’avoir été éduqué en fonction de son sexe et donc d’avoir intériorisé ces normes genrées.
ZOOM - Le plafond de verre : comprendre les contraintes qui entravent les carrières féminines
Face aux inégalités rencontrées dès les études et tout au long de leur parcours professionnel, les lois et quotas promettent de faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Mais peuvent-ils vraiment briser le plafond de verre ?
Le terme « plafond de verre » désigne l’ensemble des barrières, souvent invisibles, qui freinent la progression des femmes vers les postes de haut niveau. Il illustre la persistance des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Des éléments tels que le sexisme, les inégalités salariales, le congé maternité, la durée du travail et l’accès aux formations de haut niveau constituent autant d’obstacles à l’ascension.
Même lorsqu’une femme bénéficie d’une formation de haut niveau, elle n’est pas garantie d’accéder aux postes les plus élevés.
Les processus internes de promotion et de gestion de carrière restent souvent défavorables. Les normes du management valorisent la mobilité, la disponibilité et la compétitivité des caractéristiques généralement alignées sur un modèle masculin, tandis que les obligations familiales limitent la possibilité pour les femmes de s’y conformer entièrement. L’accès restreint aux réseaux et au mentorat, ainsi que l’évaluation des compétences selon des critères genrés, réduisent encore les opportunités.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’après l’INSEE, en 2019 les femmes représentaient seulement 21 % des dirigeants salariés et 39 % des dirigeants non-salariés, alors qu’elles constituent près de la moitié des salariés du secteur privé. Au sein de la fonction publique, elles occupent 63 % des emplois mais seulement 42 % des postes de direction. Et en 2022, seulement trois femmes dirigeaient une entreprise du CAC 40, représentant ainsi 3,75 %.
Pour répondre à cette inégalité structurelle, plusieurs lois ont été adoptées : la loi Copé-Zimmermann (2011) impose 40 % de femmes dans les conseils d’administration, la loi Avenir professionnel (2018) instaure un index obligatoire d’égalité professionnelle, et la loi Rixain (2021) prévoit des quotas de 30 % de femmes cadres dirigeantes en 2026, puis 40 % en 2029. Bien que ces mesures soient louables, elles ne parviennent pas à défaire un obstacle enraciné dans la culture, les standards et les pratiques des entreprises.
Laura Drouin

