Face aux discriminations et aux préjugés qui touchent les religions, le groupe local Coexister Lille mise sur le dialogue, les rencontres, la sensibilisation et les actions communes afin d’unir les jeunes au-delà de leurs différences. Depuis 2009, Coexister France, rassemble des jeunes de 15-35 ans de différentes convictions religieuses, spirituelles ou non et philosophiques et propose des solutions pour vivre ensemble. Matthias Gomez, engagé depuis 2021 au groupe local de Lille, aujourd’hui vice-président de l’association y met son énergie, convaincu que les jeunes peuvent apprendre à vivre ensemble malgré leurs différences.
« On a des difficultés à faire porter ce sujet unique », affirme-t-il. Le vivre-ensemble n’est pas une évidence. Dans le monde, les religions suscitent souvent de la méfiance et génèrent des tensions. Ici, l’ambition est de recréer du lien dans une société où les religions font peur. « En parler n’est pas un retour en arrière, mais une manière d’avancer », ajoute-t-il.

Les préjugés, un obstacle au vivre-ensemble
Mais d’où viennent ces préjugés ? Souvent, l’intolérance ne naît pas de la haine, mais de la méconnaissance. Dès l’enfance, l’éducation religieuse ou familiale peut influencer la perception de l’autre, parfois en enfermant les jeunes dans des représentations stéréotypées. Dans certains milieux, la religion de l’autre est perçue comme une menace. À cela s’ajoute la stigmatisation médiatique, certaines croyances sont régulièrement associées à la violence ou à l’extrémisme, renforçant la peur et la méfiance.
La laïcité est mal comprise et devient parfois un prétexte pour exclure alors qu’elle devrait garantir la liberté de croire ou de ne pas croire. Tout cela forge un climat où les différences religieuses inquiètent. Matthias le constate, « On a du mal à faire comprendre que la foi peut être une force de lien et pas de division. ».
Un petit groupe de jeunes lancent la première action en 2009. Se réunir autour d’un don du sang interreligieux alors que le conflit israélo-palestinien déchirait les communautés. Quinze ans plus tard, Coexister est devenue une association nationale avec une quinzaine de groupes locaux, dont Lille, pour montrer aux jeunes qu’il est possible de vivre ensemble malgré les différences.
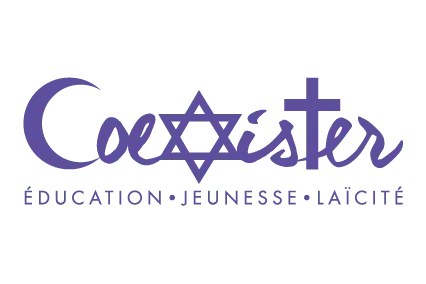
Apprendre à se connaître
Le parcours du coexistant repose sur quatre étapes : la rencontre, le dialogue, des actions solidaires et la sensibilisation. Cela se traduit par des actions simples et puissantes comme les soirées Kawaa, visites de lieux de culte, ramassage de déchets … On raconte d’où peuvent venir les préjugés pour les déconstruire et lutter contre les discriminations.
« Ces actions créent de vraies amitiés », sourit Matthias. Les formations abordent le fait religieux et la laïcité, sujets souvent mal compris. « Si on ne crée pas de lieux pour en parler, on renforce les peurs et on se condamne à ne jamais se rencontrer », résume-t-il. Selon les études de l’association, 88 % des jeunes passés par Coexister affirment avoir changé leur regard sur d’autres convictions. Ces chiffres révèlent surtout un besoin crucial : améliorer la formation religieuse ?
Matthias le répète : « Ce n’est pas de la tolérance. Un ami, on ne le tolère pas. On est en coexistence active avec lui, parce qu’on connaît réellement son histoire. » Cette phrase dit tout de la démarche de Coexister. Il ne s’agit pas de convaincre, mais de comprendre. Pas de gommer les différences, mais de leur donner un visage.
Coexister ne prétend pas résoudre toutes les divisions. Mais à son échelle, l’association trace un chemin. C’est celui d’une coexistence active. Au-delà des convictions ou des non-convictions, c’est le dialogue qui relie, c’est là que commence la fin des discriminations.
– Marine Lemaitre
Photos : Daphné Carlier
ZOOM
Quand la foi devient virale : les nouveaux visages de la religion sur les réseaux sociaux
Sur les réseaux sociaux, comme YouTube, Instagram, TikTok, certains religieux ont choisi de suivre le mouvement des nouvelles générations. En plus de leur statut religieux, certains ont aussi un statut d’influenceurs. Suivis par des milliers de viewer ils parlent notamment de foi, de relations humaines ou le sens de la vie dans un langage simple et accessible.
Parmi eux, Sœur Albertine, religieuse catholique originaire de Lille, partage régulièrement son quotidien sur les réseaux. Elle répond sans tabous aux questions de ses abonnés. Ses vidéos, sous format court d’abord centrées sur sa vie religieuse, abordent désormais des sujets plus larges liés à la foi et à l’existence, explique t-elle dans un reportage du CNN. Dans un entretien avec ELLE, elle affirme ne pas faire de prosélytisme : transmettre la foi n’est pas manipuler. Elle ne cherche ni à convertir ni à imposer Dieu, mais à partager librement sa croyance : “Je partage cette bonne nouvelle, et chacun en fait ce qu’il veut.”
A Roubaix, l’imam Franco-marocain Abdelmonaim Boussenna, revendique “l’islam du juste”, une vision équilibrée et contextualisée, en phase avec les valeurs républicaines. Il s’oppose à l’extrémisme djiadiste dès 2018 et encourage l’éducation religieuse en ligne via Dini TV.
Du côté de la communauté juive, le rabbin Mendel Narboni utilise les réseaux pour rendre le judaïsme plus visible et accessible. Dans une interview avec Alohanews, il déplore la discrétion de sa communauté, souvent liée à la peur des insultes ou de l’antisémitisme, et choisit au contraire d’afficher sa foi en portant la kippa sans honte, pour casser les tabous. Sur TikTok, il aborde la banalisation de l’antisémitisme, défend le dialogue entre religions et rappelle que les réseaux ont aussi le pouvoir de diffuser des messages de paix.
Néanmoins, certains influenceurs religieux propagent, tout de même, des idéologies radicales, réactionnaires et conservatrices. Par exemple, en France, des comptes Instagram ou TikTok, souvent anonymes, surfent sur le regain du nationalisme fondé sur les “racines chrétienne” du pays et la montée de la droite radicale pour imposer des idéaux racistes, misogynes ou homophobes aux adolescents et jeunes adultes, souvent en manque de repères dans une société en mouvement permanent.
-Perrine Carton

